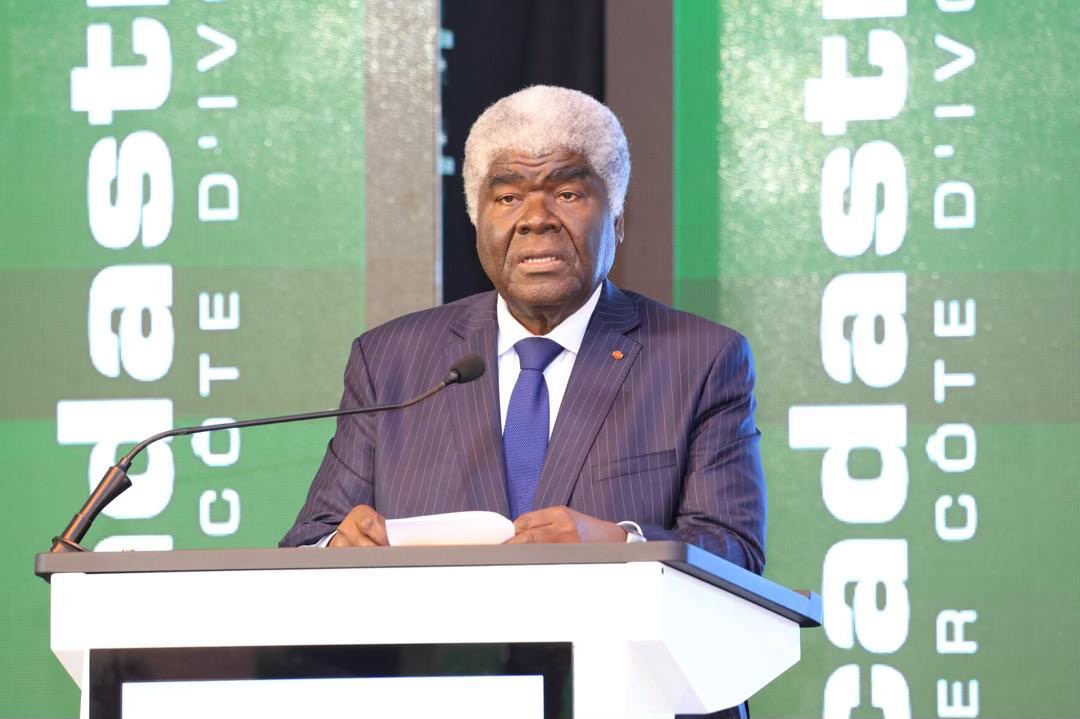Niger – Gouvernance minière : les inquiétudes de la société civile face aux engagements de Somida
À Agadez, la société civile tire la sonnette d’alarme sur les pratiques de la Société minière de Dasa (Somida), opérateur canadien-majoritaire dans l’uranium nigérien, et appelle à une gouvernance plus inclusive et respectueuse des engagements sociaux et environnementaux.
Un contexte stratégique sous tension
Au Niger, pays riche en ressources uranifères mais confronté à d’importants défis de gouvernance, l’implantation de la Société minière de Dasa (Somida) suscite un débat croissant. Filiale détenue à 80 % par la société canadienne Global Atomic Corporation et à 20 % par l’État nigérien, Somida prévoit d’exploiter un important gisement d’uranium près de Dasa, entre Agadez et Arlit. Or, malgré l’envergure stratégique du projet, les travaux de construction de l’usine d’extraction n’ont pas encore abouti, tandis que les inquiétudes des communautés locales se multiplient.
La voix des populations locales
Depuis août, des chefs coutumiers et villageois ont demandé à Somida de respecter ses engagements en matière de développement local. La société civile, désormais en première ligne, réclame notamment une meilleure prise en compte des besoins des habitants, l’attribution prioritaire des emplois aux jeunes d’Agadez, ainsi qu’une nouvelle étude d’impact environnemental. Celle-ci devrait garantir la protection des richesses naturelles et culturelles du désert, où subsistent encore des peintures rupestres, des sites funéraires ancestraux et des lieux de culte fragiles.
Les enjeux de gouvernance et de responsabilité sociale
Au-delà des revendications immédiates, la controverse autour de Somida révèle des problématiques plus larges de gouvernance minière. Les populations dénoncent des déplacements forcés sans compensation, l’entrave à la circulation sur certaines routes locales, ainsi que la menace pesant sur leur patrimoine immatériel. Dans ce contexte, la société civile insiste sur la nécessité pour l’État de faire respecter les lois, indépendamment des intérêts des compagnies étrangères, afin de préserver la justice sociale et la cohésion nationale.
Un impératif d’équilibre entre croissance et durabilité
L’affaire Somida illustre les tensions récurrentes entre exploitation industrielle des ressources et droits des communautés locales. Si l’uranium constitue une manne stratégique pour les finances publiques et pour l’intégration du Niger dans les chaînes de valeur mondiales, son exploitation ne saurait se faire au détriment de l’environnement, du patrimoine culturel et des droits humains.
Une gouvernance transparente, des mécanismes de responsabilité sociale crédibles et une participation active des communautés locales apparaissent dès lors comme des conditions sine qua non pour garantir un développement inclusif et durable.
Une opportunité pour refonder le contrat minier
En définitive, le cas de Somida met en lumière la nécessité pour le Niger de renforcer son cadre réglementaire et institutionnel en matière de gestion extractive. L’enjeu n’est pas seulement de sécuriser les investissements étrangers, mais aussi de créer une véritable valeur ajoutée locale, en favorisant l’emploi, l’industrialisation et la préservation du capital naturel.
Dans un contexte où les ressources minières peuvent être autant une bénédiction qu’une source de tensions, le respect des engagements et l’innovation en matière de gouvernance constituent la clé pour transformer l’exploitation de l’uranium en levier de prospérité durable pour le pays et ses populations.
Partagez cet article :